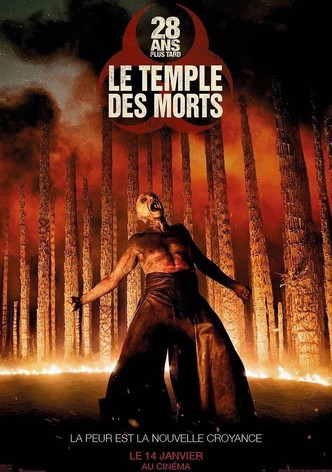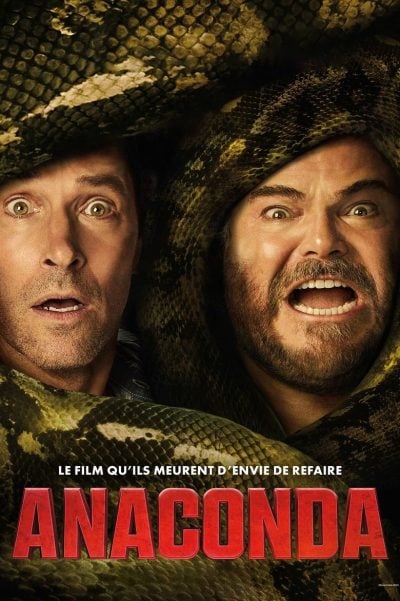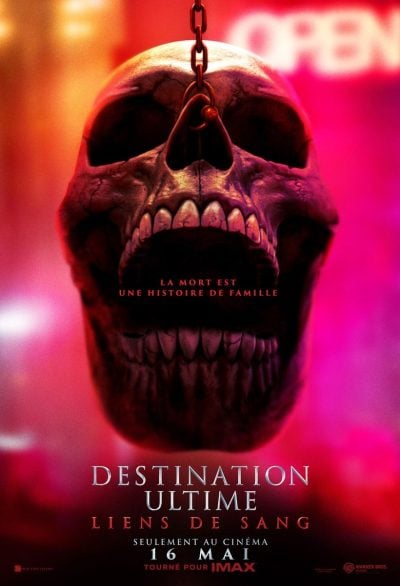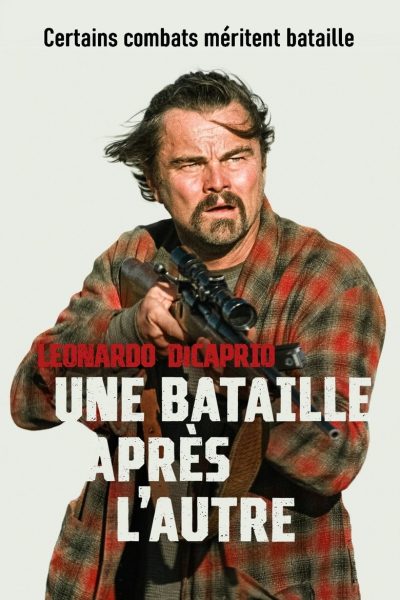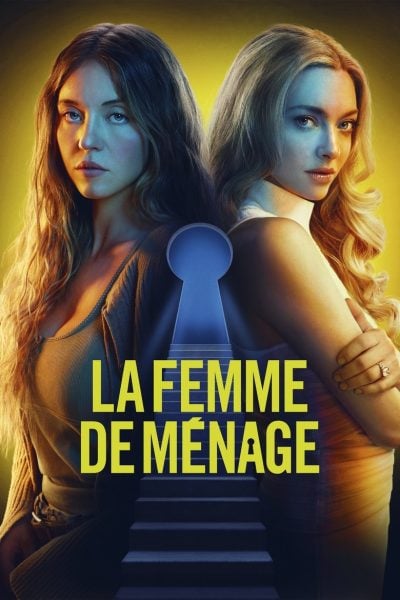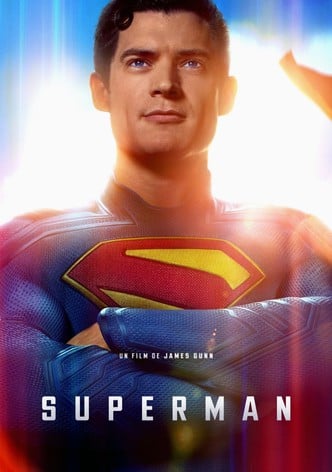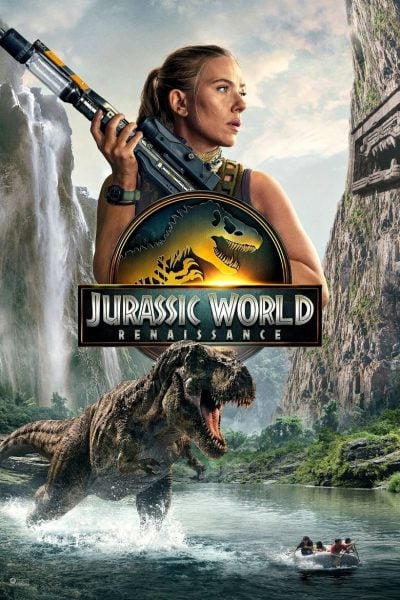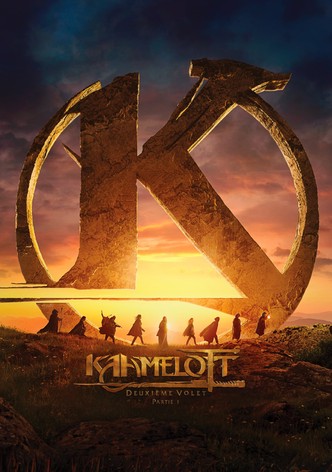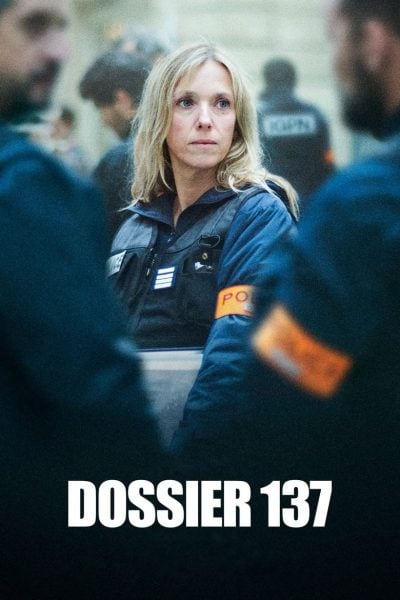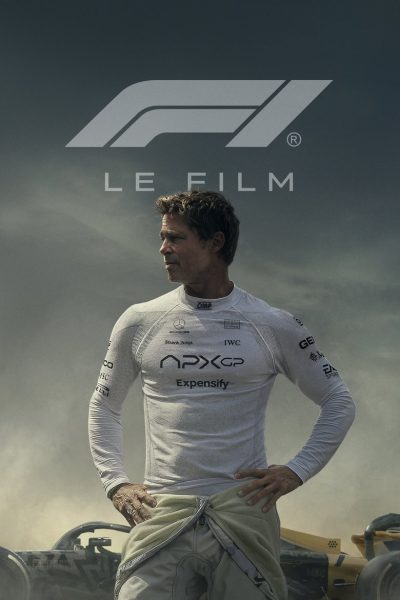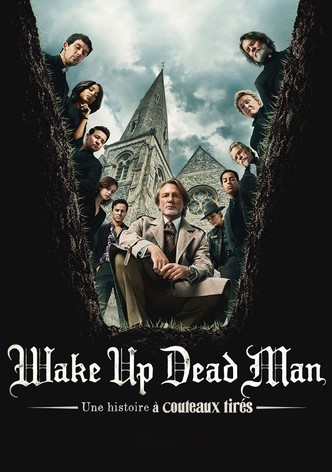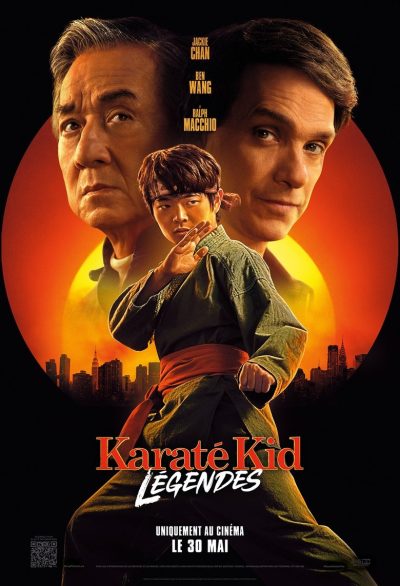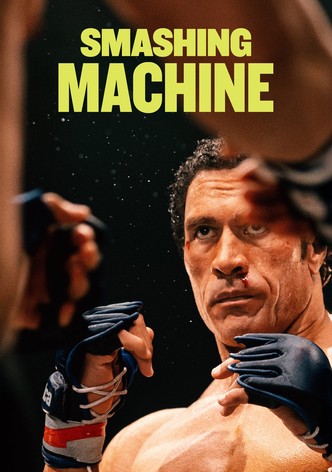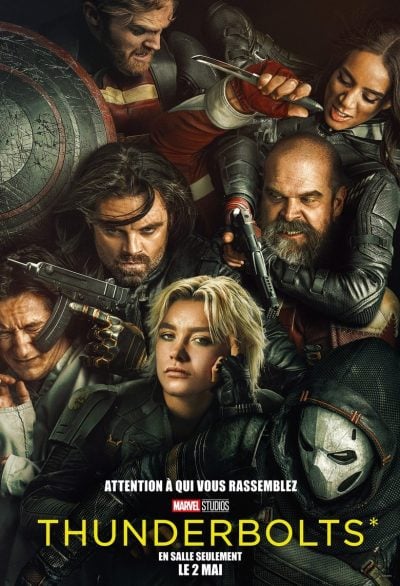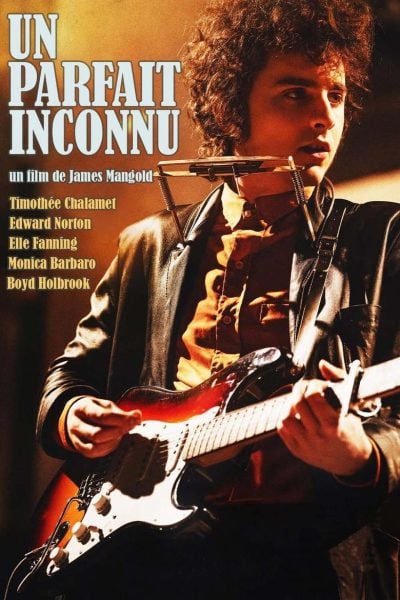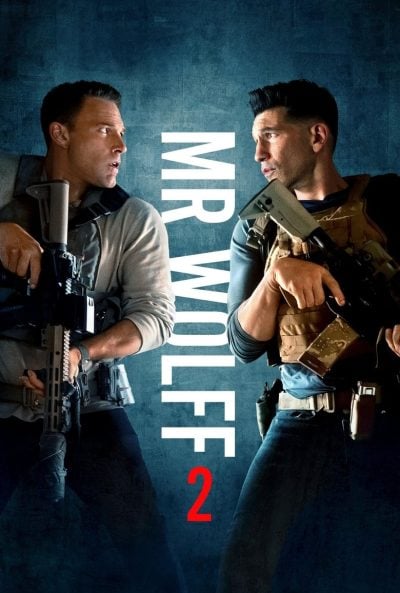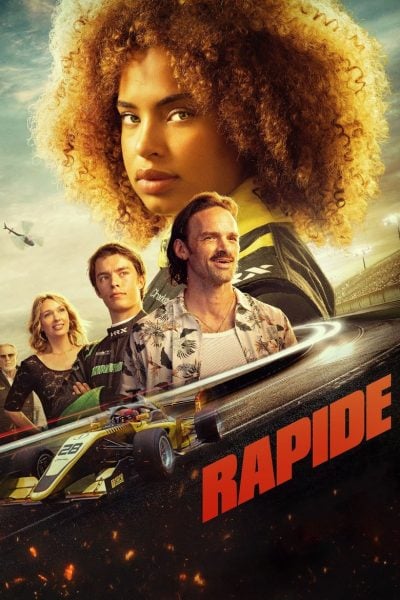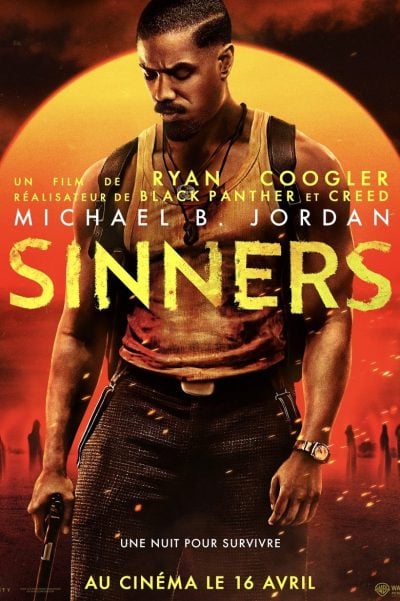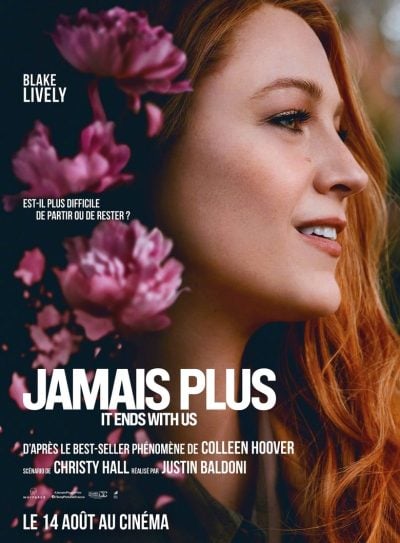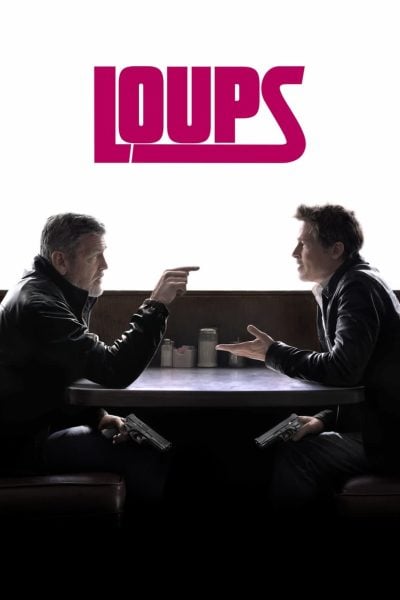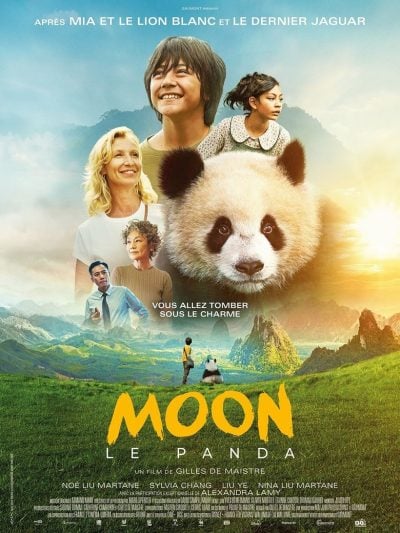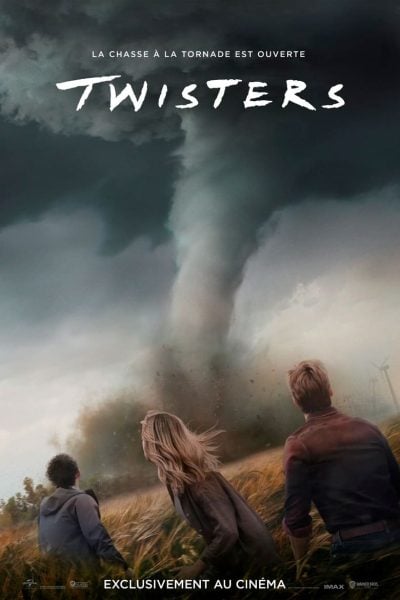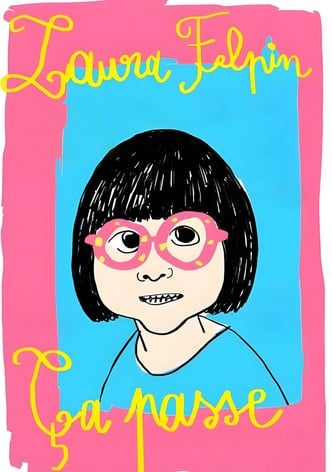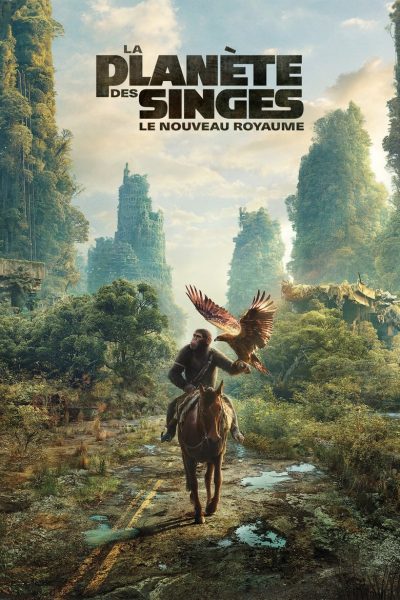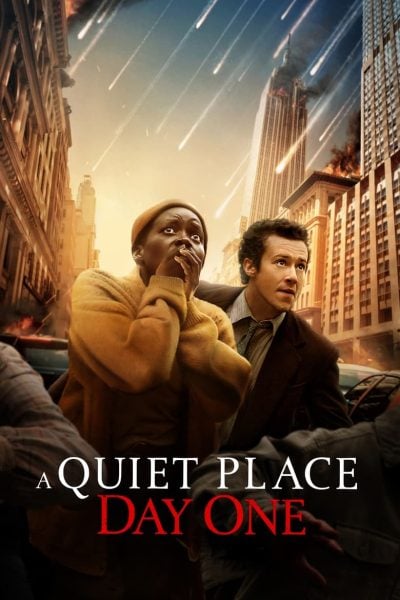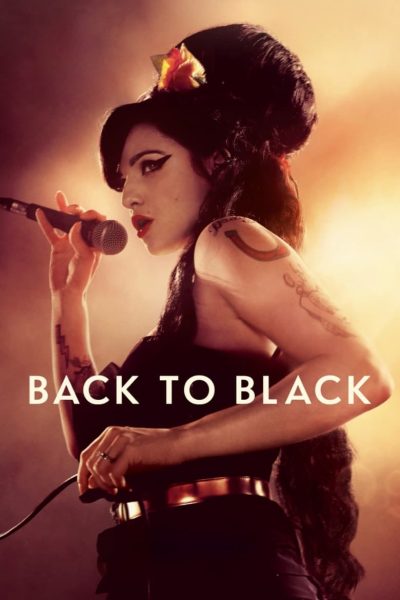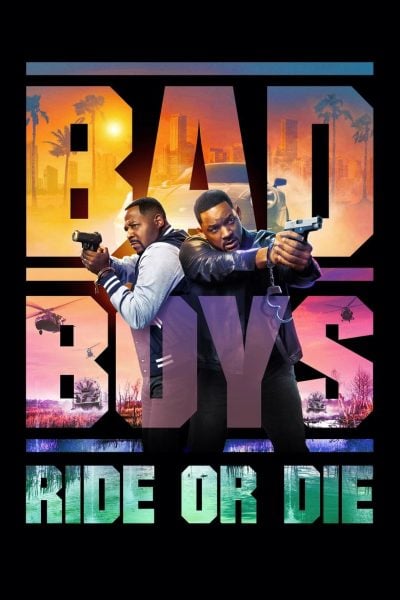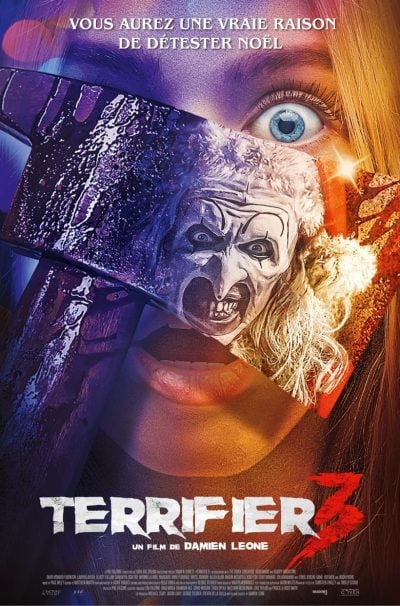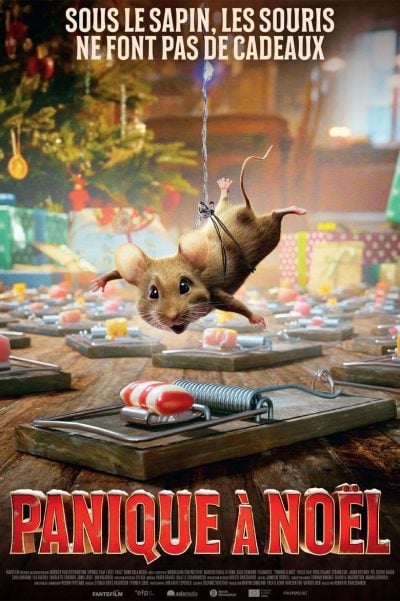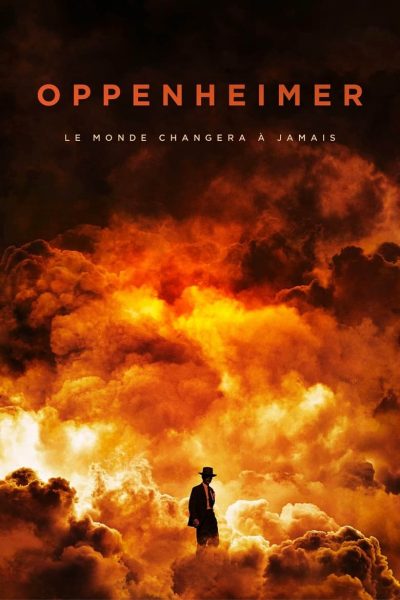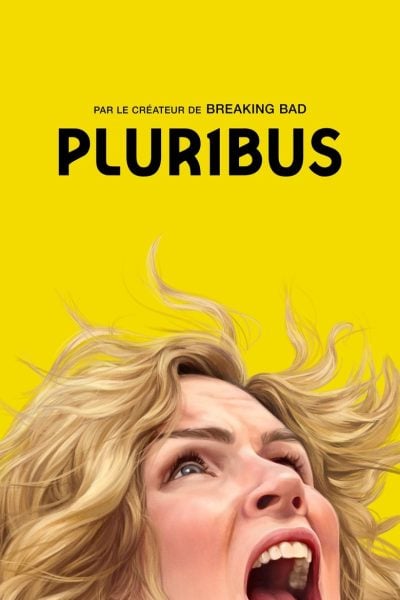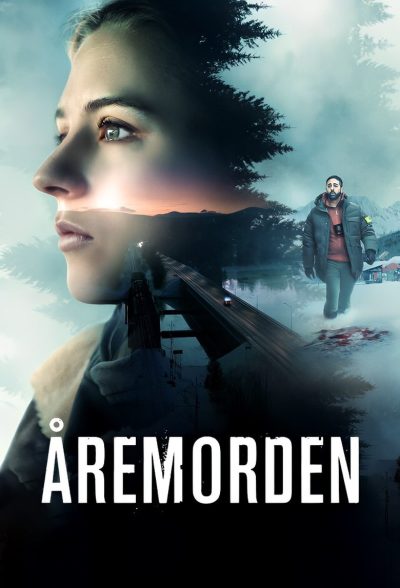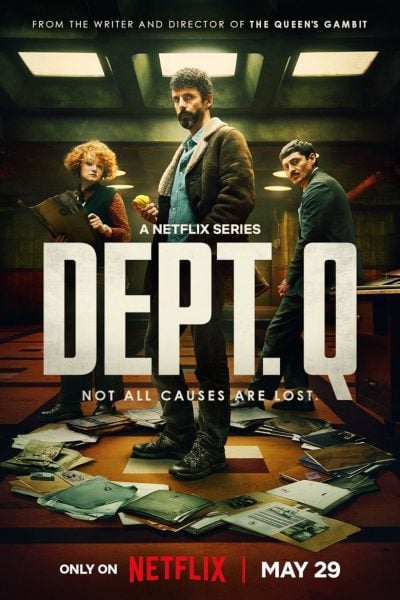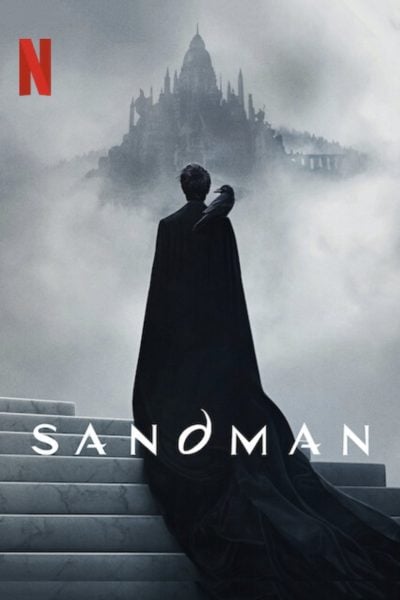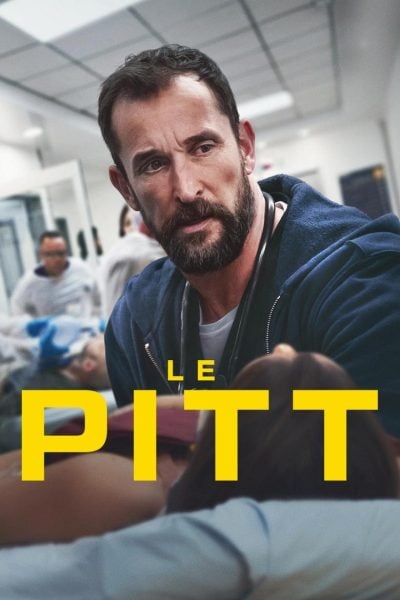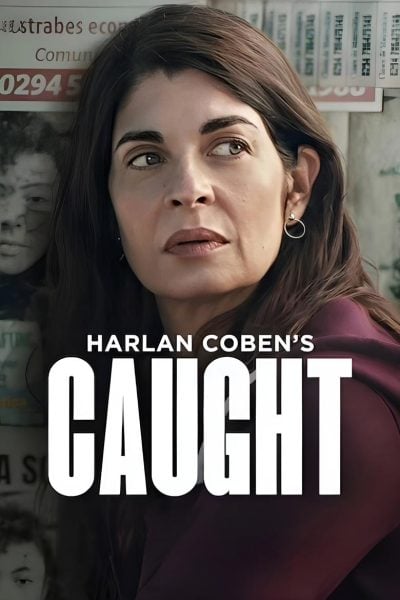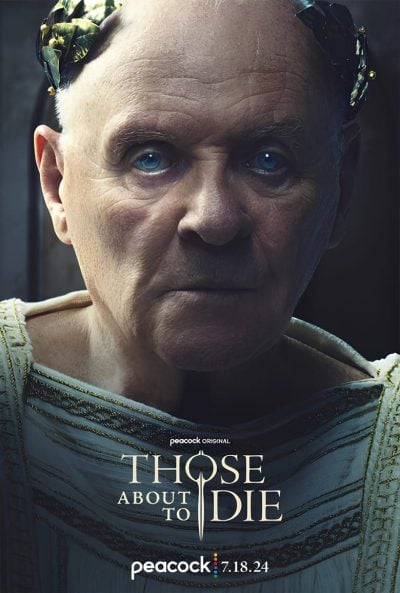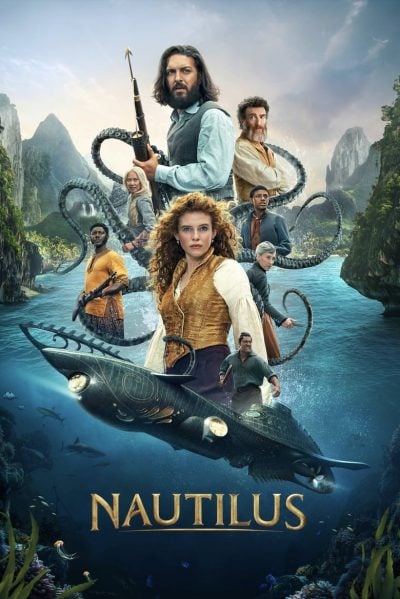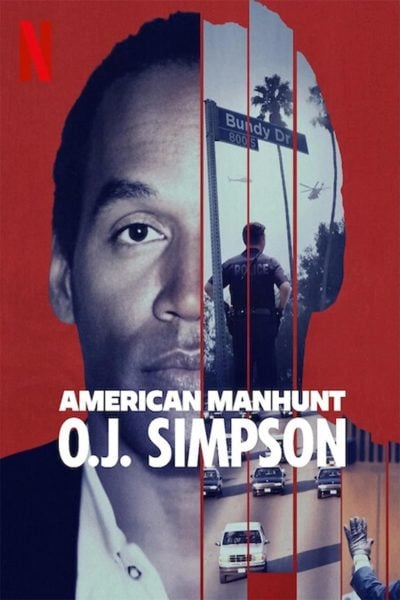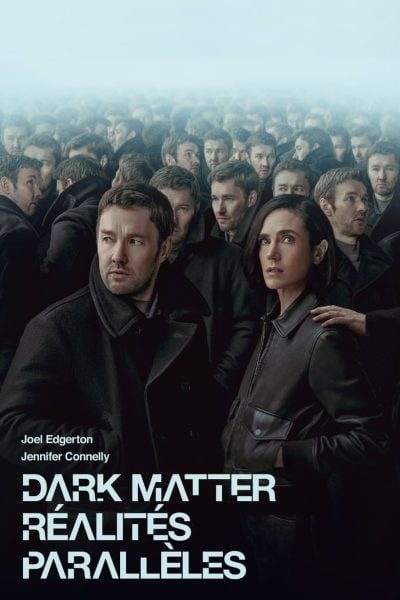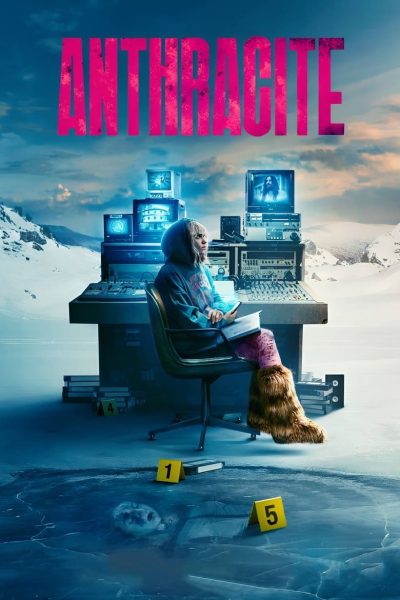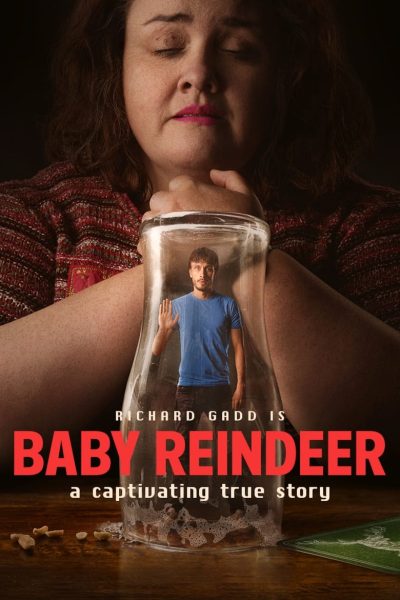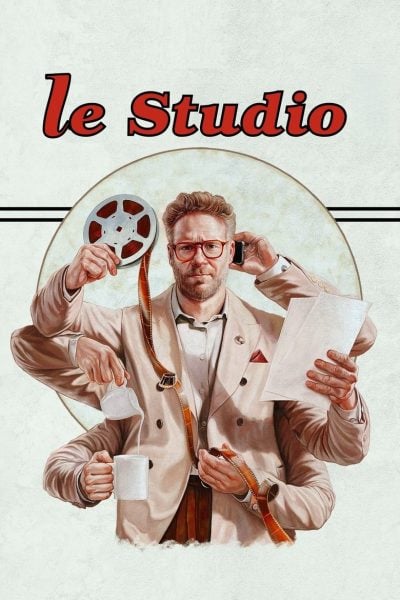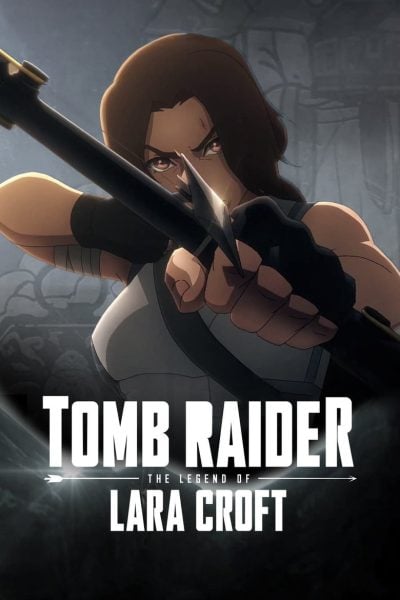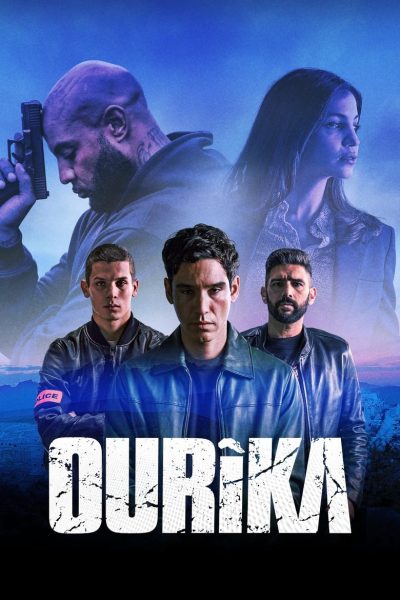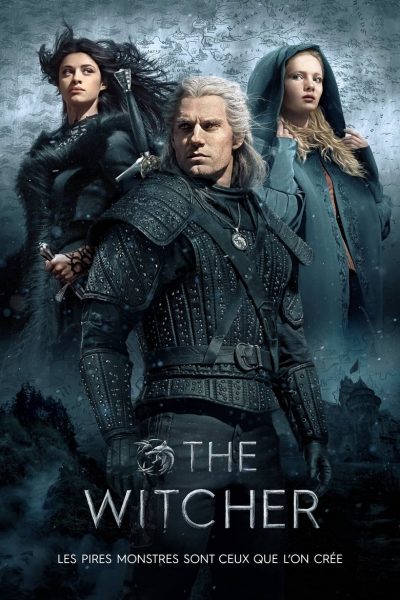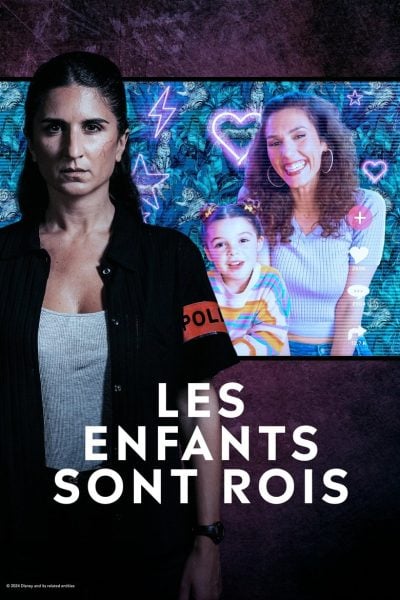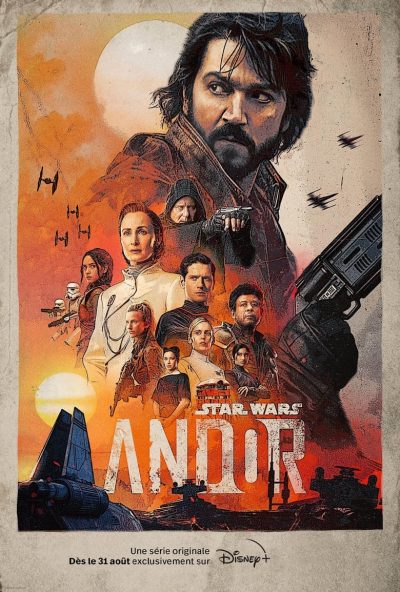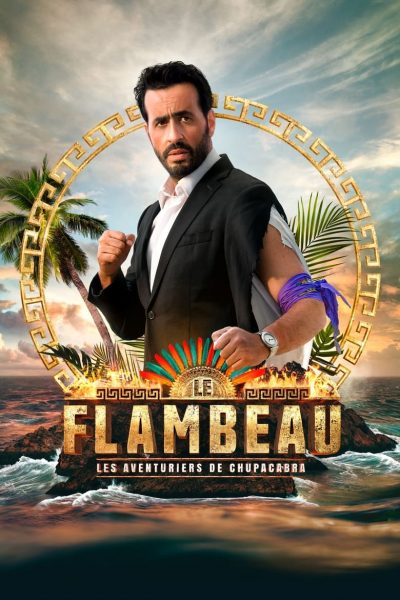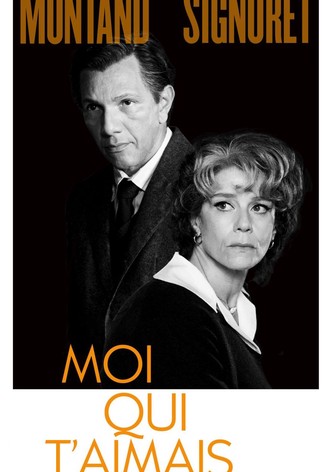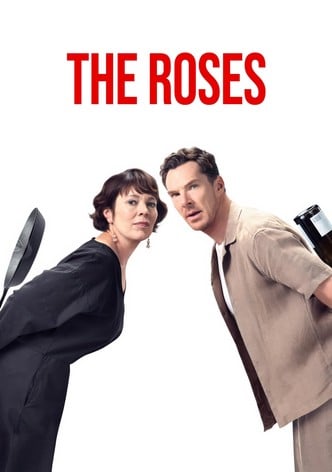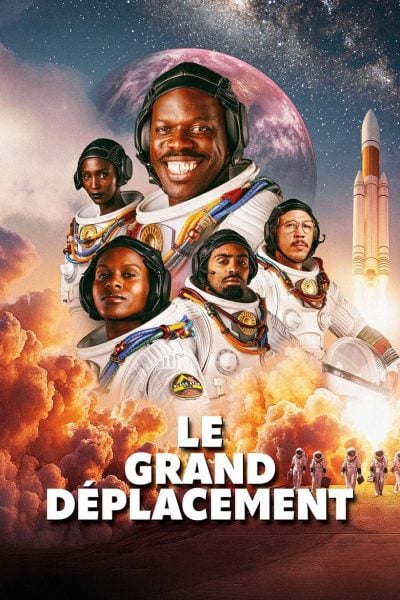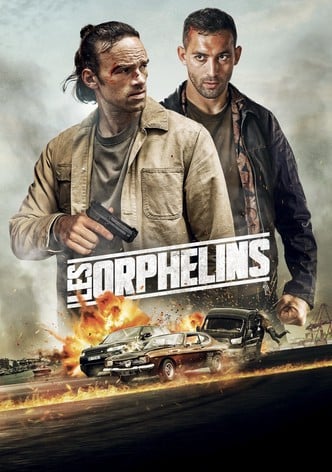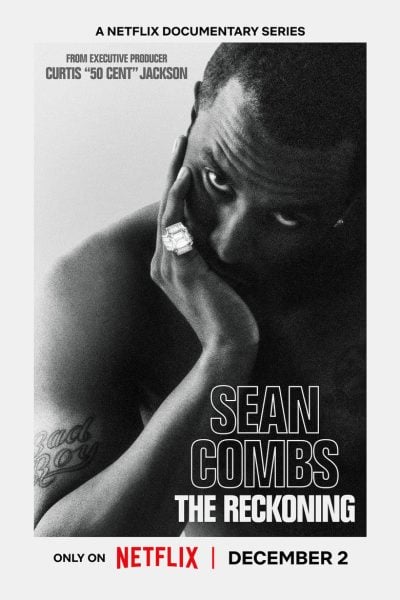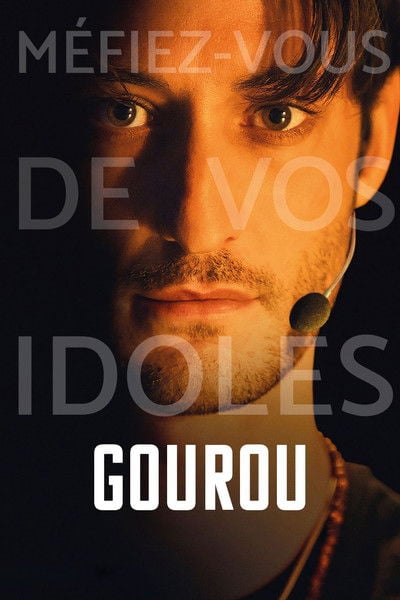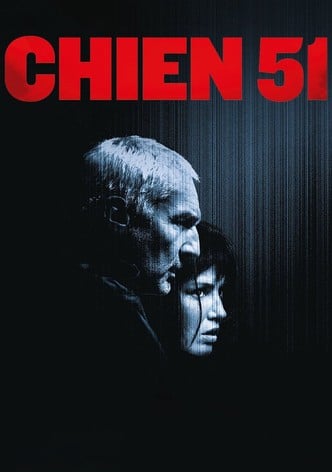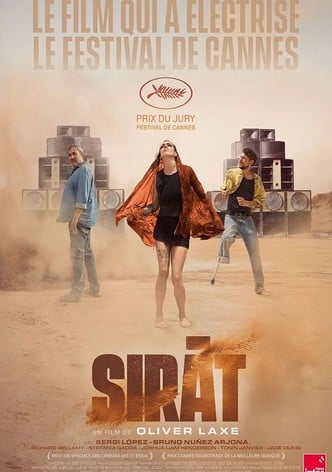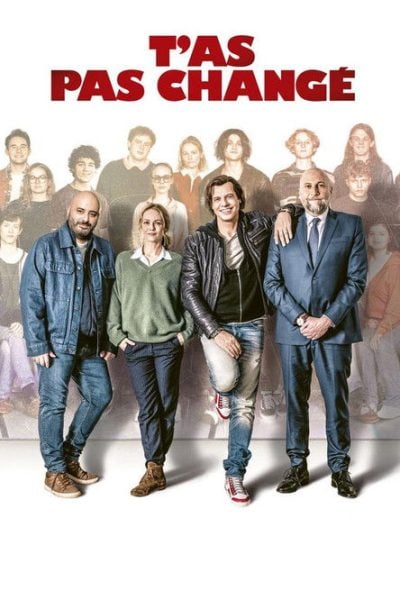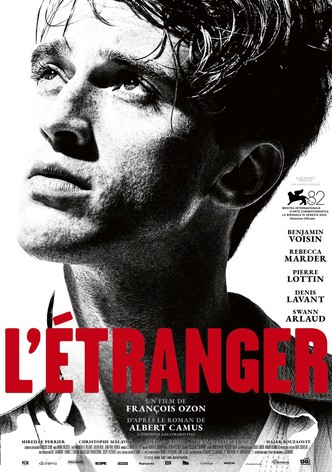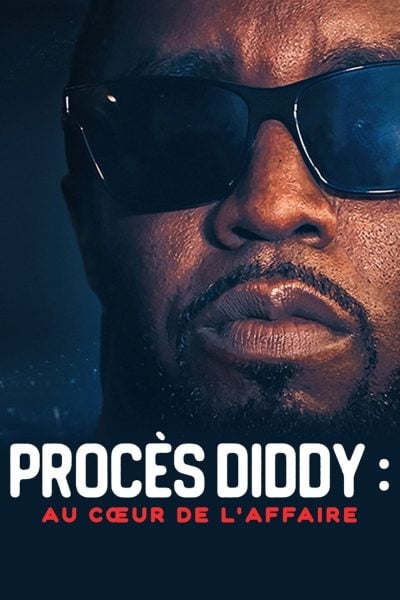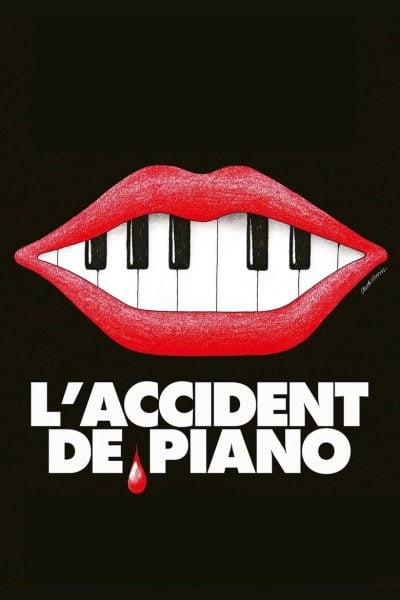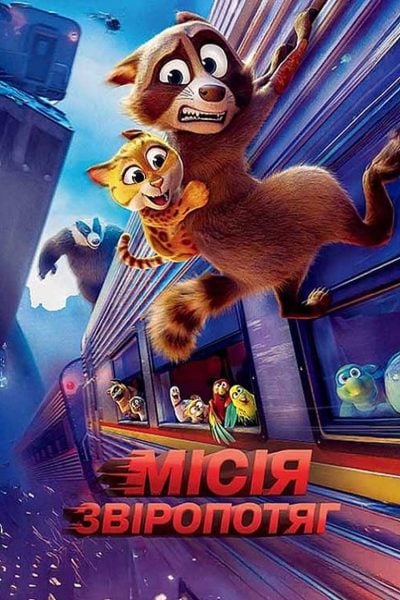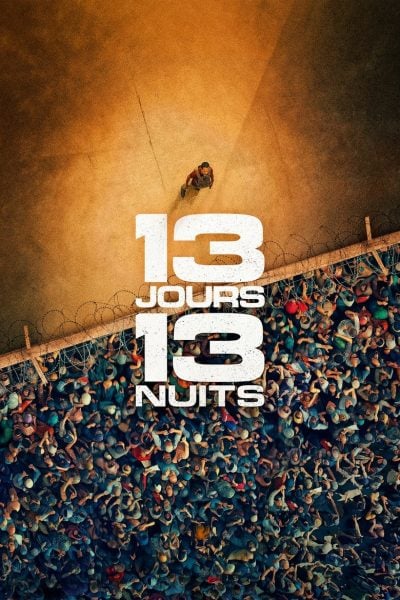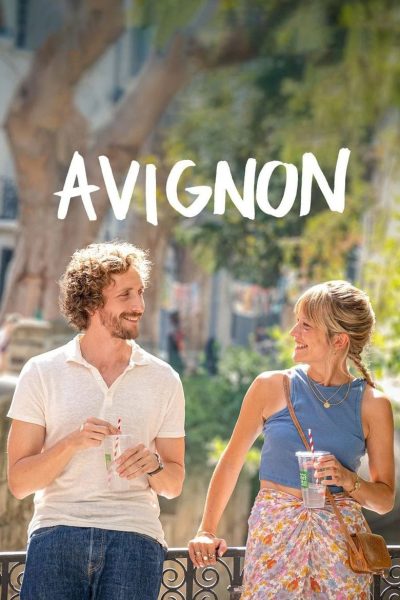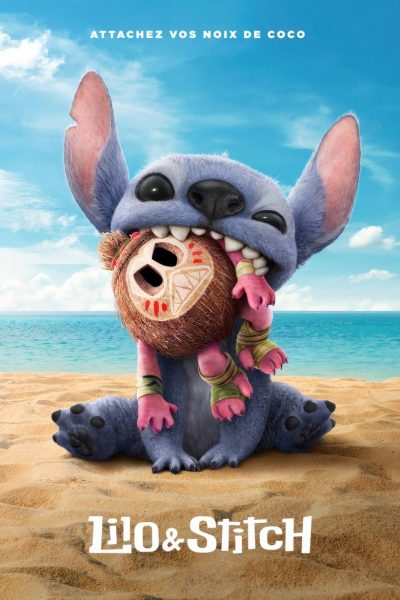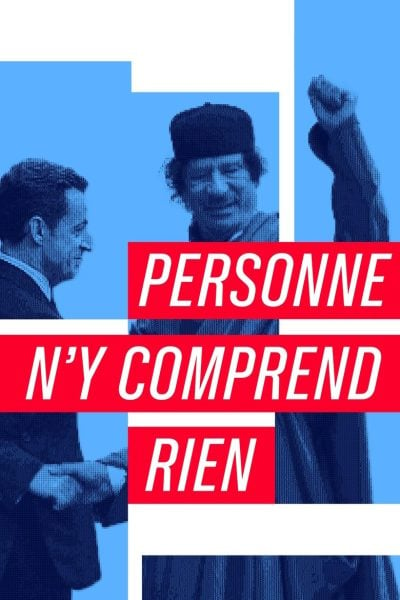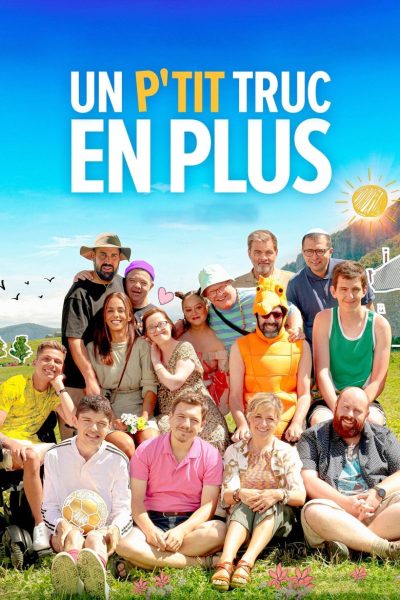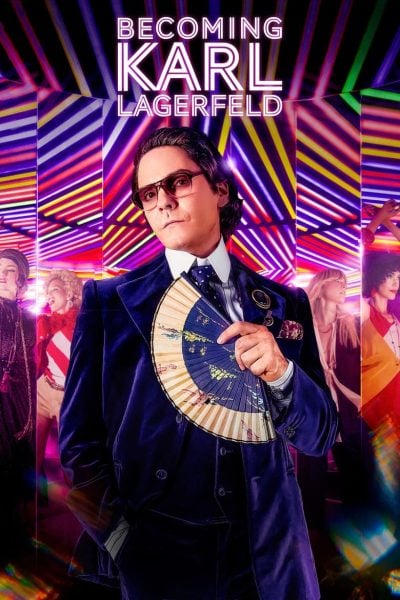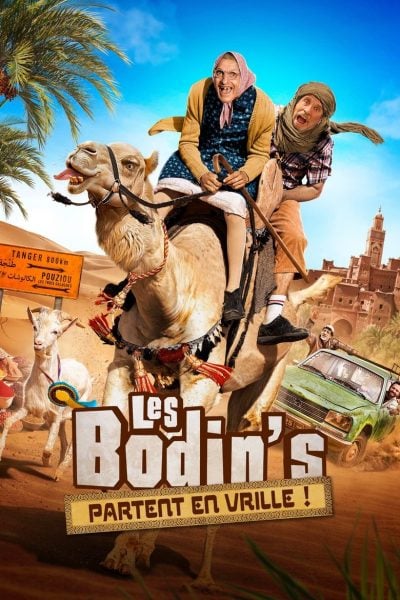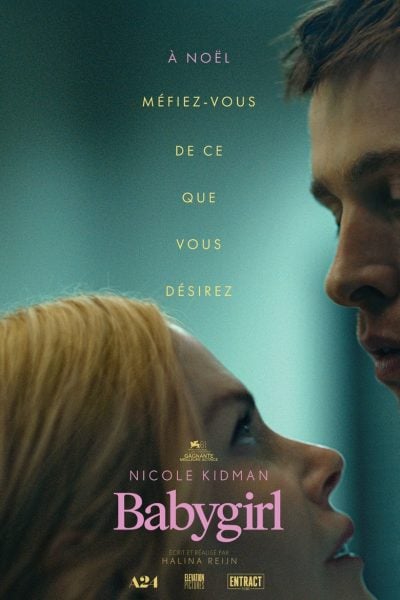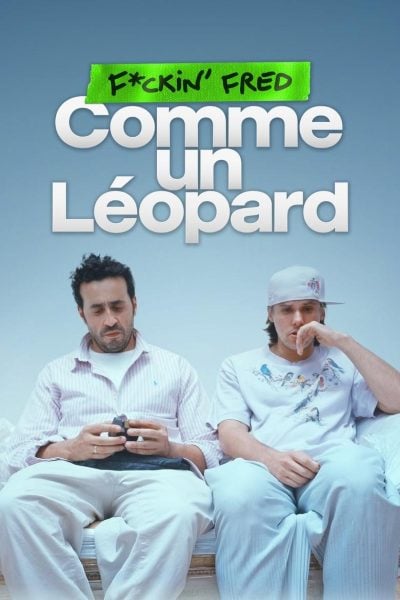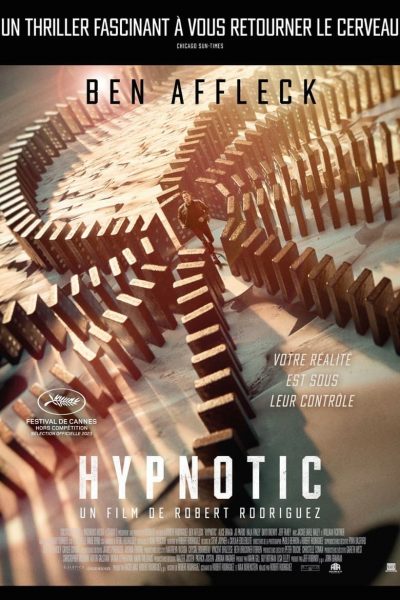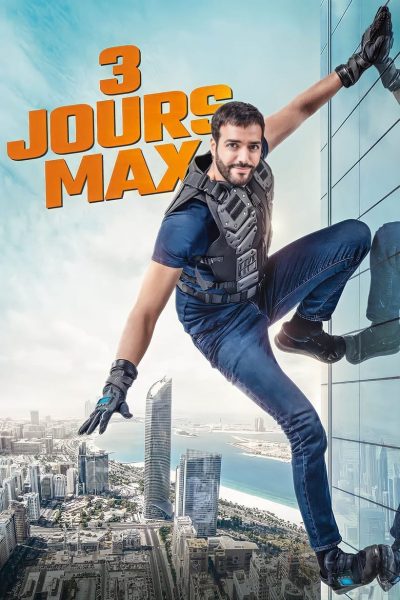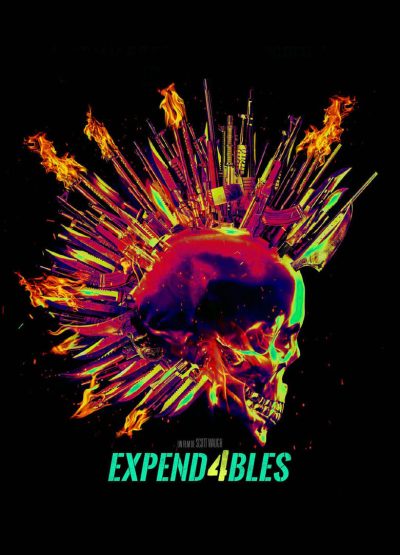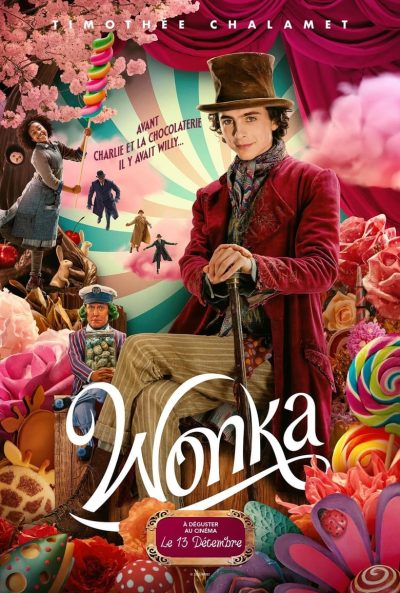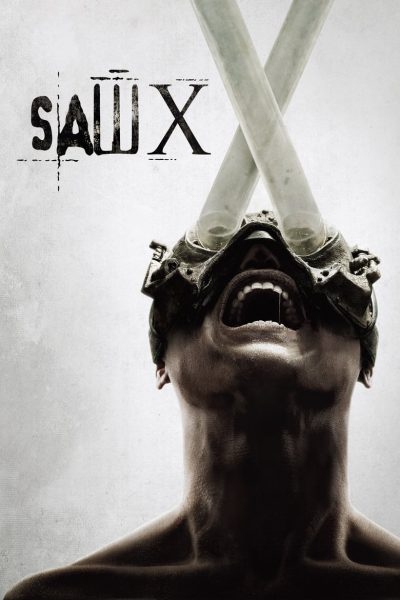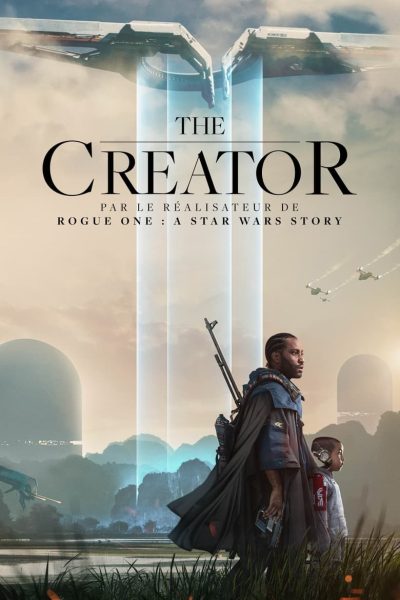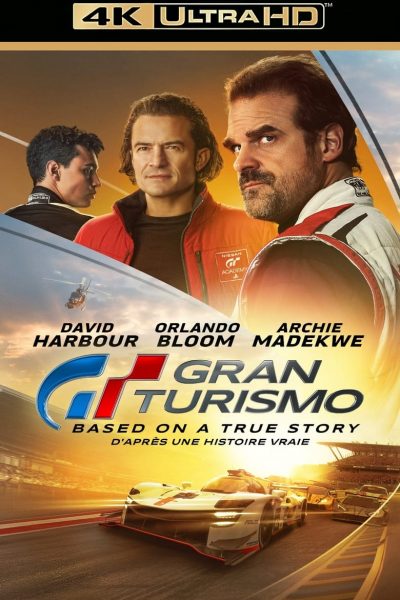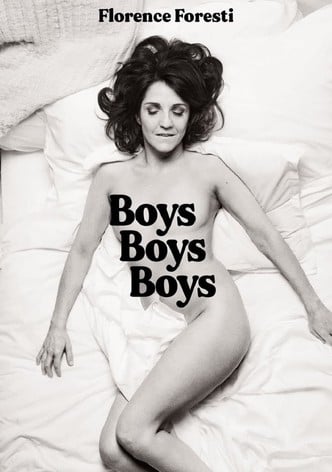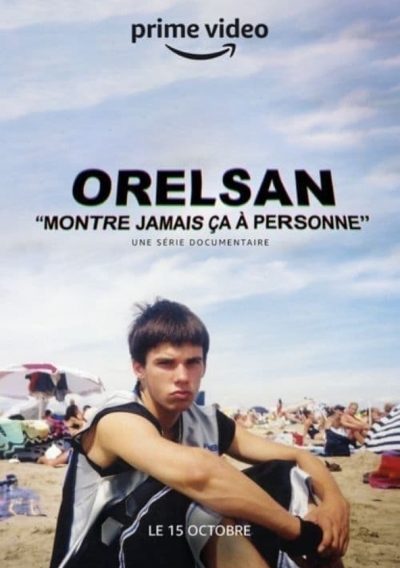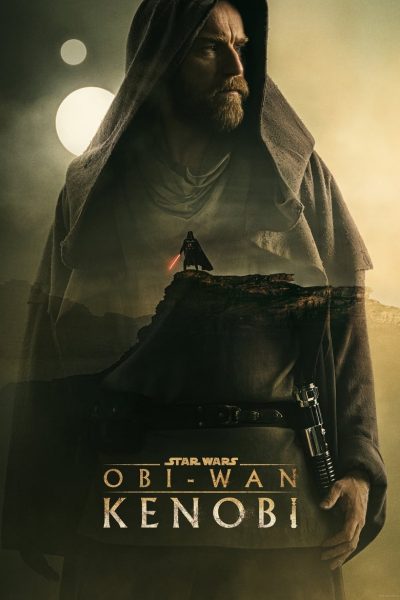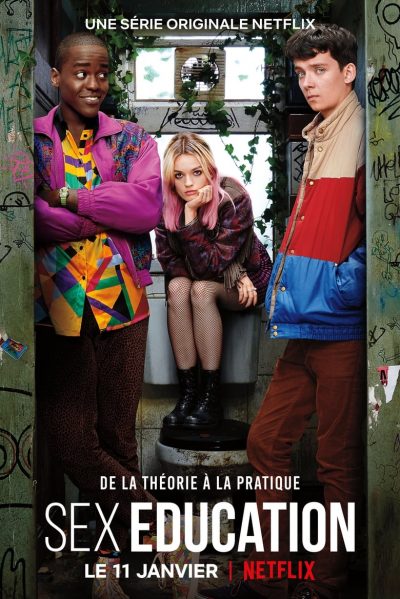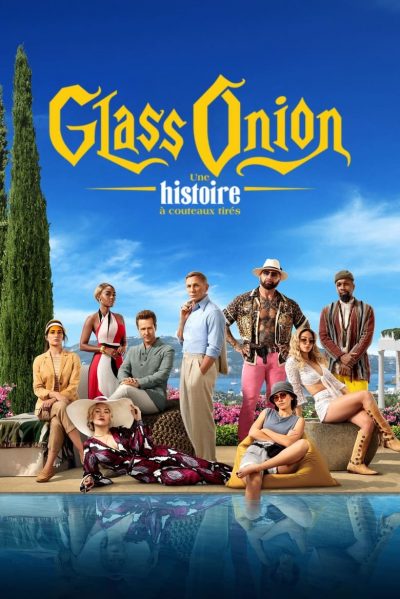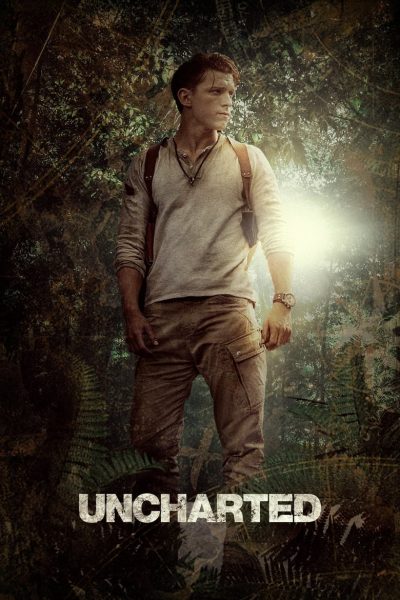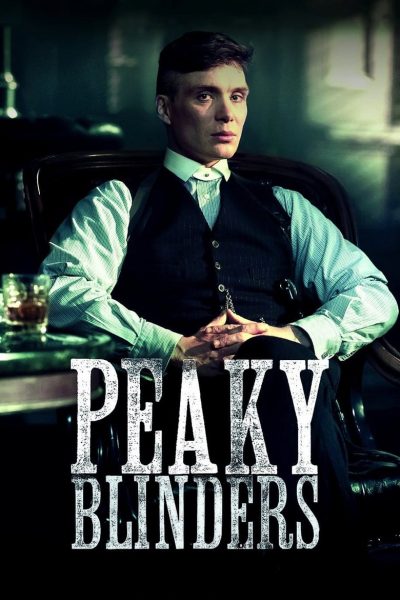Derniers Ajouts

La "Ségothèque" est une bibliothèque alternative dédiée exclusivement à l'univers du cinéma et des séries télévisées. Son objectif est de fournir un espace unique où les amateurs de films et de séries pourraient explorer, apprendre et partager leur passion.
La Ségothèque vise à être un espace unique pour l'exploration, l'apprentissage et le partage autour du cinéma et des séries. Elle est conçue pour aller au-delà d'une simple collection de films et de séries, en devenant un centre culturel et éducatif.